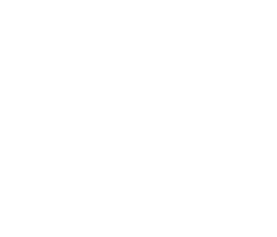Interview de Barbara Mathevon
Membre du bureau du Groupe de travail Pays en développement & Biodiversité

©Barbara Mathevon
Barbara, vous travaillez aujourd’hui en tant que Chargée de projets ressources naturelles/aires protégées au sein du GRET. Pouvez-vous vous présenter, et préciser notamment les raisons qui vous ont conduit à travailler dans la protection de la nature ?

Je suis environnementaliste et travaille depuis 17 ans sur la protection de la biodiversité à l’international.
Je suis tombée dans la protection de l’environnement depuis toute petite. Le premier métier que je voulais faire était éboueur ! J’avais par ailleurs une grande empathie pour les animaux et les plantes et la disparition silencieuse des espèces me bouleversait autant que d’écraser un escargot. Je me souviens qu’on me trouvait trop sensible mais je ne me retrouvais pas du tout dans une conception de l’Homme dominant la nature. J’ai commencé très vite à monter pleins de petites actions à mon échelle à l’école, notamment pour collecter des dons pour les campagnes espèces du WWF. J’étais aussi très réceptive au marketing des maisons d’édition qui collaboraient avec les associations de protection de la nature, comme les fiches animaux à collectionner qui coutaient 10 francs les 20 premières fiches et beaucoup plus cher les suivantes. Un jour nous avions oublié de payer le deuxième lot d’une collection de fiches de la Fondation Cousteau, nous avons reçu une lettre de mise en demeure et j’ai eu très peur que cela ne fasse avorter ma carrière dans la conservation !
Mais mon envie de travailler sur la biodiversité dans les pays du sud vient du film La forêt d’Emeraude, de John Boorman, qui raconte le destin du fils d’un ingénieur travaillant sur un chantier de barrage en Amazonie qui est enlevé par des indiens et avec lesquels il grandira ensuite. Le film montre surtout les ravages de l’industrialisation sur les modes de vie autochtones et les écosystèmes amazoniens. Je ne suis pas sûre que ce soit un très bon film, mais en tout cas ça a été un déclic pour moi et j’ai souhaité alors orienter mon parcours vers les forêts humides.
Aujourd’hui, au vu de la façon dont l’état de la biodiversité mondiale s’est considérablement aggravé en 30 ans, je ne vois pas d’engagement ayant plus de sens à mes yeux que celui-ci.
Quel est votre parcours professionnel et quelles sont vos plus belles expériences ?
J’ai d’abord travaillé 7 ans dans une ONG malgache, L’Homme et l’Environnement, sur la conservation d’une forêt littorale (la réserve de Vohibola) et le développement local, puis en tant que Directrice adjointe de cette ONG. Je suis ensuite rentrée en France et j’ai intégré au bout d’un an le programme international du Comité français de l’UICN sur la gestion du Programme de Petites Initiatives du FFEM. Ça m‘a donné l’opportunité de suivre plus de 150 projets portés par la société civile africaine en faveur de la biodiversité et du climat. Ces projets sont de véritables laboratoires d’innovation sociale et un vivier d’intelligences collectives. Ce qui m’a donné rapidement envie de remonter des projets de terrain et j’ai rejoint il y a 8 ans l’ONG de solidarité internationale française Gret en tant que responsable de projets aires protégées.
J’ai fait le choix de travailler dans une ONG dont le cœur de métier est l’ingénierie sociale et qui dispose d’expertises très diversifiées parce qu’il me semblait que les principaux défis auxquels font face les aires protégées des pays en développement relèvent prioritairement de questions d’organisations sociale, de gouvernance, d’harmonisation avec les politiques publiques et de questions sectorielles (énergie, agriculture et filières) plutôt que d’expertise écologique. Elle est bien sûr nécessaire mais ne répond qu’à une partie des problèmes.
Difficile de choisir mes plus belles expériences mais Vohibola a été incontestablement la plus forte car c’était une immersion de 7 ans dans la culture malgache et les modes de vie des pêcheurs de la Côte Est et une très grande aventure humaine, personnelle et professionnelle.
Pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans la conservation de la biodiversité à l’international et en particulier dans les pays en développement ?
En fait je voulais combiner mon envie de voyager, de travailler sur la biodiversité remarquable, tout en découvrant des cultures basées sur un autre rapport à la nature. Au Bénin par exemple, pays du vaudou où il existe de nombreuses divinités de la nature et de la chasse, ces liens culturels et spirituels à la nature sont forts et peuvent servir de leviers efficaces pour la conservation de la biodiversité. Les fétiches, qui sont là pour rappeler le caractère sacré des mangroves par exemple, sont bien plus respectés que les lois issues du droit positif et les mangroves sacrées sont préservées. A Madagascar, parce que le modèle de la société occidentale séduit de plus en plus les jeunes générations comme partout dans le monde, la revitalisation des anciennes règles coutumières peut non seulement servir à la gestion durable des écosystèmes, mais préserver également des savoirs faire et des traditions qui se perdent. Celles-ci relevaient pourtant souvent de régulation durable des usages de la nature que l’économie de marché a bouleversé. Cette revitalisation peut contribuer aussi à une meilleure cohésion sociale entre les générations. D’autre part, en zone rurale, au plus petit niveau sociétal, le village, il y a une dynamique de participation citoyenne aux questions qui relèvent de l’intérêt général incroyable et héritée des traditions précoloniales. Les gens consacrent beaucoup de temps dans les assemblées villageoises pour se concerter et aboutir à des décisions consensuelles. C’est un excellent terreau pour prendre des décisions socialement acceptées et traiter des questions environnementales, des biens communs qui, par définition, engagent la société à voir à long terme et au-delà des intérêts individuels.

Mangrove à coté du Parc marin de Nosy Atafana, où le Gret intervient sur l’ appui à la gouvernance des territoires littoraux – ©GRET
Le succès que rencontre l’approche par les Communs dans les pays du Nord pour sortir des piliers de la société moderne, l’individualisme et la privatisation, a bien été construite par Elinor Ostrom à partir d’expériences du sud ou les communautés ont été capables de s’organiser pour gérer durablement leurs ressources naturelles. Il faut ainsi puiser dans les pays du sud l’inspiration pour réinventer nos modèles sociétaux et promouvoir plus de participation citoyenne car celle-ci porte avec plus d’ambition l’intérêt général et donc l’avenir de la planète.
Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez aujourd’hui et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontée dans le cadre de vos actions ? Les réalisations dont vous êtes la plus fière ?
Je suis à nouveau basée à Madagascar et je suis deux projets sur les aires protégées (Réserve de Biosphère de Mananara Nord et Future aire marine protégée de Sainte Marie) et un autre projet au Viet Nam dans la Réserve de Pu Luong. Nous y intervenons sur le soutien au développement rural et sur la facilitation d’une gouvernance plus inclusive des AP et des aires de conservation communautaires.

Parc marin de Nosy Atafana dans la réserve de Biosphère de Mananara Nord où le Gret intervient sur l’ appui à la gouvernance des territoires littoraux – ©GRET
Nous sommes confrontés à de très nombreux défis, notamment certains que je qualifierai de « classiques » tels que le décalage entre le temps d’empowerment des communautés locales dans la gouvernance et la gestion des aires protégées et la nécessité de mettre en place des mesures immédiates pour enrayer le déclin des ressources, qui ne mettent pas en péril leurs moyens d’existence. Il est nécessaire également que les conditions de gouvernance au niveau des autorités permettent de restaurer la confiance avec la population et de les faire collaborer efficacement. Enfin le manque de financements pérennes nous pousse à investir un temps considérable dans leur recherche, au détriment de nos actions sur le terrain, et génère un stress permanent sur la continuité des processus que nous accompagnons et qui nécessitent du temps.
D’autres défis sont liés au contexte. L’artificialisation des espaces littoraux sous la pression climatique, démographique et foncière s’accentue de plus en plus dans le Nord Est malgache. Dans cette région, qui est le bassin de production de la vanille de Madagascar, nous misions beaucoup sur le développement de la vanille pour compenser les attraits du trafic de bois de rose venant des parcs nationaux. En réalité, le besoin en terres pour la culture de vanille a également généré de la déforestation. Il faut ainsi travailler sur des approches intégrées du paysage et une prospective territoriale mettant l’ensemble des acteurs autour de la table pour harmoniser les objectifs de développement et de conservation.

Reboisement de la PCADDISM à Kalalao – ©GRET
D’autres défis sont conjoncturels et liés aux conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale.
A Sainte Marie par exemple, le chômage massif entrainé par la suspension du tourisme a provoqué le retour de beaucoup de ménages vers l’exploitation des capitaux naturels qui constituent toujours un filet de sécurité en période de crise, mais qui a accéléré la perte irréversible des ressources forestières notamment. D’autre part, les saint mariens sont en train de céder à très bas prix tout leur patrimoine foncier à des opérateurs étrangers, y compris des espaces naturels, et l’île risque de se transformer à terme en une succession d’hôtels et de zones privatisées auxquelles ils n’auront plus accès, ni eux, ni leurs enfants.
Si les terres cultivables disparaissent et que la présence d’étrangers génère une inflation des prix, cela fait peser des risques sévères sur la sécurité alimentaire de ce territoire qui connait en outre une forte croissance démographique. Par ailleurs, les écosystèmes se fragmenteront encore plus et les services écologiques se dégraderont. Je ne dis pas qu’il faut empêcher le tourisme, car celui-ci est fondamental pour l’économie de Sainte Marie, mais la planification territoriale doit bien intégrer l’ensemble de ces enjeux.
La réalisation dont je suis la plus fière est sans doute ce projet à Sainte Marie où nous avons accompagné depuis 2015, avec mes collaborateurs du Gret Sainte Marie, l’émergence d’une gouvernance territoriale avec une forte implication des communautés locales (rassemblées dans une association qui s’appelle la PCADDISM[1]) dans la protection de l’environnement et la résolution des conflits sociaux. Aujourd’hui elle est reconnue par les bailleurs de fonds du fait de son ancrage communautaire et a acquis une légitimité locale, et les autorités composent en partie avec elle. Ce projet me donne beaucoup d’espoir pour montrer les bénéfices apportés par la démocratie participative à Madagascar sur l’environnement, mais je crois que le mérite revient surtout à l’engagement des saint mariens.

Réunion communautaire pour élaborer le Dina Be (règle coutumière qui concerne tout le territoire) de Sainte Marie organisée par le Gret et la PCADDISM relatif à une meilleure gestion environnementale – ©GRET
Quel est votre espèce favorite et pourquoi ?
C’est le goéland (sans préférence pour une espèce particulière) pour plusieurs raisons : parce qu’il me rappelle ma ville préférée, Marseille, où ils sont partout, sur les toits, dans les rues, dans tous les quartiers, dans les calanques, à côté des nageurs. Ce n’est pas une cohabitation des plus heureuses mais c’est tellement important de croiser encore de la vie sauvage en ville. Et aussi parce qu’il véhicule dans notre imaginaire collectif, grâce au goéland le plus célèbre, Jonathan Livingston, une image de liberté, de non conformisme et de quête d’absolu. Ce n’est pas tout de suite ce à quoi on pense en le voyant dans les poubelles de Marseille mais lorsqu’on le voit planer dans un coucher de soleil depuis le palais du Pharo, on l’imagine plus philosopher que penser au goût des derniers restes de pizza qu’il a mangé.
Il y a aussi le poulpe. Qui a suivi un jour en snorkeling un poulpe mimétique est frappé d’un émerveillement à vie.
Comment voyez-vous l’avenir de la planète et les nombreux défis qui se posent aujourd’hui pour concilier à la fois les enjeux de protection de la nature et de développement ?
Plusieurs aires protégées où j’ai travaillé sont aujourd’hui en péril et font face à des enjeux sur lequel il nous est impossible d’avoir une prise, notamment la présence djihadiste (par exemple dans le Parc de l’Arly dans l’Est du Burkina et à proximité de la zone à girafe de Kouré, au sud du Niger, qui était un succès en matière de gestion communautaire). Les prévisions du GIEC nous disent que 70 % des récifs coralliens disparaitront si on reste sur une trajectoire de 1,5° et 99% si on est sur un scenario +2°, alors que nous sommes plutôt engagés sur un +3°. A Madagascar, l’USAID vient de tirer la sonnette d’alarme sur l‘AP du Menabe et sa spectaculaire Allée des baobabs à laquelle il ne resterait plus que 4 ans avant sa disparition totale. À l’échelle du pays, il ne resterait que 10 ans d’espérance de vie aux lémuriens.
Difficile de rester optimiste dans le contexte actuel et face à l’avalanche de mauvaises nouvelles climatiques et écologiques. Le réalisme nous pousse à envisager à moyen terme l’effondrement de pans entiers de la biodiversité et à nous préparer à faire le deuil de ce qui disparaîtra. Cette perte est particulièrement rapide dans les pays où je travaille. Mais nous avons néanmoins le devoir de rester optimistes et d’engager toute notre énergie et notre intelligence pour inverser la tendance.
Personnellement je crois beaucoup à la jeunesse du monde entier et à sa capacité à construire de nouveaux récits, à l’émergence d’une classe politique capable de faire preuve du courage dont la planète a besoin. Cette génération est de plus en plus en quête d’engagement professionnel qui ait un sens et réponde à des valeurs. J’espère que cela se traduira par des révolutions profondes et rapides dans les entreprises pour intégrer davantage d’objectifs sociaux et environnementaux.
Il est difficile de répondre à cette difficile et vaste question de la conciliation des enjeux de conservation & développement en quelques lignes, nous avions d’ailleurs sorti un ouvrage au Gret qui s’appelait « Conservation de la nature et développement. L’intégration impossible ?[2]». Evidemment il faut déjà changer notre consommation au Nord mais j’enfonce des portes ouvertes : consommer mieux, moins et sur des circuits courts. Il faut être conscient du fait que ce que l’on consomme au Nord et qui vient du Sud provient souvent de filières où la rémunération des producteurs les maintient en dessous du seuil de pauvreté, y compris sur certaines filières certifiées équitables. Les consommateurs du Nord doivent s’interroger sur le coût social et environnemental associé aux produits qu’ils achètent. Nous travaillons ainsi au Gret de plus en plus sur les filières locales et nationales de nos pays d’intervention pour promouvoir un développement plus sobre en carbone et répondant à une demande et des besoins locaux.

Récifs coralliens dans la Réserve de Biosphère de Mananara-Nord classés en APGL (Aire de pêche gérée localement) où le Gret intervient en soutien à leur gouvernance et au développement rural – ©B.Mathevon
On parle beaucoup de résilience en ce moment et je trouve que les populations des pays du sud qui éprouvent régulièrement le passage de crises construisent des stratégies d’adaptation basées sur la diversification des activités économiques résilientes alors qu’au Nord, nous sommes dans une société de l’archi-spécialisation. Nous avons tendance à tout envisager sous l’angle économique dans nos approches de l’APD[3] alors que la résilience sociale est centrale, dans les sociétés malgaches par exemple. Leur résilience est toutefois mise à mal avec le changement climatique, la montée de l’individualisme et la demande du marché international sur certaines ressources prisées (vanille) qui les pousse à concentrer leurs efforts sur une seule activité économique, alors que la demande du marché peut cesser brutalement comme on l’a vu pendant cette crise sanitaire.
Je dirai que le principal challenge de ces populations consiste à ne pas reproduire nos erreurs, sortir du fantasme du modèle occidental et construire leur propre idéal de société en tenant compte des enjeux environnementaux et climatiques auxquels elles vont faire face.
[2] Conservation de la nature et développement. L’intégration impossible ? – Gret [3] Aide Publique au DéveloppementQue vous apporte votre participation au groupe de travail Pays en développement et Biodiversité et vers quelles actions le collectif doit se tourner aujourd’hui ?
Déjà l’impression d’appartenir à une famille qui se construit. Les ONG françaises qui travaillent sur la biodiversité à l’international sont nombreuses avec une grande hétérogénéité dans leur taille, leur mode d’intervention et leurs sous thématiques, mais ne travaillaient pas jusqu’à présent en réseau, à la différence des ONG de développement ou des ONG humanitaires. Or les réseaux sont nécessaires pour faire du plaidoyer sur nos thématiques.
D’autre part, le secteur des aires protégées étant dominé en Afrique par les ONG anglo-saxonnes, il est important que nous identifions mieux nos savoir-faire et nos spécificités françaises dans nos approches de la conservation et de l’aide, et de construire des synergies avec la société civile africaine francophone (mais pas que, bien entendu) qui répondent à leurs besoins et dans un esprit de complémentarité d’expertise. La France a par exemple une forte expertise sur les questions forestières tropicales et une culture de la recherche action sur l’agroforesterie considérable. Il serait intéressant de renforcer la collaboration entre les ONG françaises et les instituts de recherche français et étrangers dans nos pays d’intervention pour mieux valoriser cette production de connaissances au service du développement.
La France étant par ailleurs le 5ème bailleur mondial de la biodiversité, notre identité française et notre ancrage de terrain au sud doivent nous pousser à faire remonter ce qu’il s’y passe auprès des financeurs pour mieux orienter et dimensionner l’APD française sur la biodiversité. En Afrique, la couverture des besoins en financement pour gérer efficacement les AP est seulement de 10 à 20%. Si on n’y renforce pas les moyens dédiés à la préservation des services écosystémiques dont dépend 62% de la population rurale, nous devrons nous préparer à accueillir des vagues massives de réfugiés climatiques dans le siècle à venir.
Le premier défi de notre collectif est déjà de nous structurer pour pouvoir nous mettre en ordre de bataille sur les sujets qui nous fédèreront.